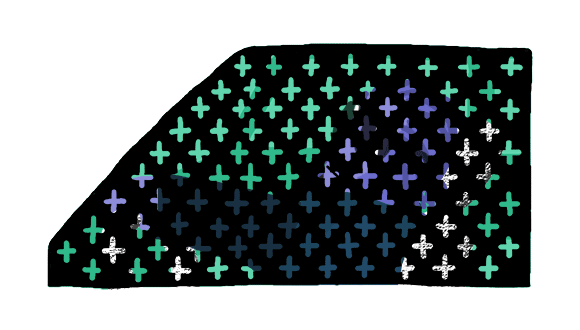
Après Cold Turkey, Starlito joue avec les mots d’une nouvelle expression idiomatique : « To wear a sheepish grin » c’est être embarrassé par ses actes, au point de ne plus pouvoir les assumer en public. En appelant son album Black Sheep Don’t Grin, Starlito en résume donc l’idée et le propos. Il y raconte sa vie, qu’il sait faites d’erreurs, de mauvais choix, d’échecs, de galères, de péchés d’orgueil et de luxure, mais sans en avoir honte, ni même chercher à se faire pardonner. Quelle est la valeur d’une confession sans repentance ? En devient-elle poétique ou pathétique ? C’est en creux la question posée par Starlito.
En étant aussi sincère et critique envers lui-même et les autres, Lito fait apparaître des contradictions. Celles d’un homme qui reproche à une femme (She just want the money) ce qu’il glorifie chez lui (I just want the money), qui s’enorgueillit de vivre une vie rapide, faites d’armes, d’argent et de sexe, tout en en parlant comme s’il traversait une maladie (« Don’t do it… I’m going through it… ») ou qui prétend vouloir être meilleur, tout en continuant de fauter. A moins que ce soit le Starlito d’aujourd’hui, mûr et presque apaisé, qui hante le jeune All-Star d’hier, qui courait après le succès tout en étant poursuivi par la police. Alors, ce qui semble être une contradiction ne serait qu’une trace laissée par un homme qui avance et continue d’avancer. (« I got this vision in my head of this new and improved me »).
Pour ses mémoires, Starlito a trempé son âme dans des samples de Stevie Wonder, de Willie Hutch, de smooth jazz et de country, pour avoir ce gangsta rap soul et éthéré qui, de Scarface à The Jacka, a toujours été la bande son favorite du « dope boy blues ». Des mélodies laidback, comme couvertes d’une légère rosée de nostalgie, propices à l’introspection, au questionnement et à l’autocritique. Et les nappes, guitares électriques et samples vocaux forment ensembles une grappe nuageuse, renforçant l’impression de solitude, comme si Starlito s’était enfermé dans un confessionnal de brume et de fumé.

Comme souvent, Starlito tient tous les rôles : sujet, acteur, metteur en scène (« I’m the coach, I’m the player and the mascot« ) parce qu’en plus de rapper sa vie de morceau en morceau, il pense son disque comme un tout, comme un film. Mais contrairement à d’autres qui rendent évident ce genre de construction d’album, lui ne fait que le suggérer… et c’est ce qui peut perdre l’auditeur, le faire passer « à côté. » Pourtant, l’intérêt de Black Sheep Don’t Grin se trouve surtout dans le fond de ses tripes. C’est un disque qui demande à être digéré longtemps, réécouté des dizaines de fois, parce que dans ses moins de trois quarts d’heure, il renferme la profondeur d’un livre de plusieurs milliers de pages. Chaque titre est un chapitre de la vie du rappeur, ensembles, ils forment ses mémoires, pris un par un ils sont des fables évoquant chacune des thèmes communs : la course à la réussite, la guerre contre ses démons intérieurs, la place de l’histoire personnelle face aux grands évènements, les limites de la loyauté, les cercles vicieux, etc… Pour le rappeur c’est une biographie, pour l’auditeur qui prend le temps de déchiffrer ses psaumes et mantras, l’album pourrait être un guide de vie.
Alors, est-ce à cela que peuvent servir des confessions sans repentance ? Starlito fait mine de poser cette question mais il en connaît la réponse. « I made mistakes so you wouldn’t have to make them » disait-il sur Cold Turkey. Ce sont des conseils donnés par quelqu’un qui a l’expérience, en somme. Et c’est à peu près ce qu’il redit dans le morceau introductif de ce nouvel album : « Get you a million dollars worth of game for a dollar twenty-nine cents » (un mp3 coûte 1$29). Quand on poussait Yams a expliquer comment, d’après lui, il fallait juger de la qualité d’un album, il répondait « Judge it by how much game you gettin from it. That’s what really makes a rap good or bad in my opinion. » Un simple calcule vous donnera une idée de la valeur de Black Sheep Don’t Grin. Mais pour s’en assurer, le mieux reste de prendre le temps de vraiment l’écouter.
illustrations : Leo Leccia
Les Princes de Nashville
« Cold Turkey »
