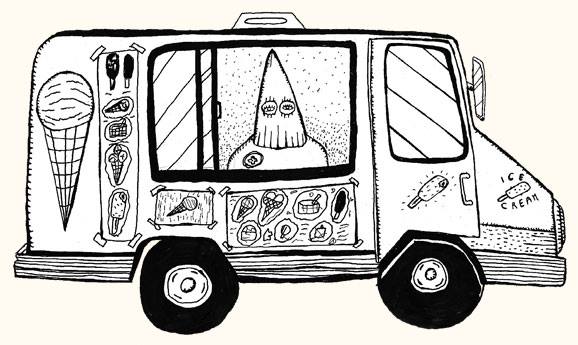Ka – The Night’s Gambit
Ka a la voix des hommes habituellement silencieux, des muets volontaires qui préfèrent se taire parce qu’ils en ont trop vu. Alors Night’s Gambit, occasion d’entrer dans les souvenirs du tourmenté Ka, sonne comme s’il avait été enregistré dans le confessionnal d’une église.
Le quartier de Brownsville tel que décrit ici est sombre, sale comme les murs d’un vieux donjon moyenâgeux dans lequel on s’enfonce lentement au cours du disque. Le timbre monotone et calme de Ka, son flow quasi susurré et conversationnel, aident à nous plonger, inexorablement, dans les abysses de Brooklyn et là où le MC se cache ; où il se cache de la crasse de New York et du regard de Dieu, qu’il ne veut surtout pas voir en témoin de ce que la vie de Brownsville l’a forcé à faire.
On retrouve, comme dans Grief Pedigree, les textes fourmillants de références, labyrinthes de détails qui demandent plusieurs écoutes afin d’en connaître chaque recoin. Mais là où Ka fait un vrai bon en avant par rapport à son précédent album, c’est du côté des productions. Celles-ci participent grandement à la sensation d’écouter le disque dans une vieille église abandonnée. Des samples très discrets et des bass qui le sont toutes autant, pour que l’ensemble ne soit rien de plus que la bande son des scènes décrites par Ka. Parfois presque absentes, les rythmiques peuvent êtres remplacées par des bruitages sourds, comme ces mécanismes d’horloges sur « Our Father » qui semblent résonner depuis la boite crânienne en ébullition du rappeur. Seules quelques prods plus soul viennent faire respirer l’auditeur, sinon étouffé dans cette ambiance pesante, qui donne l’impression de nous faire porter, avec Ka, le monde sur nos épaules. Ecouter « Peace Akhi » au casque, oppressé par sa production lente et industrielle, et sous la canicule de ces derniers jours, est une expérience au moins aussi traumatisante que de porter une doudoune dans un sauna.
Avec Knight’s Gambit, Ka tient son meilleur album et un des meilleurs projets de l’année. Et il prouve que l’on peut approcher la quarantaine, faire du rap connoté 90’s, tout en continuant à expérimenter et à proposer une musique neuve et personnelle.
Tree – Sunday School II
L’église où nait la musique de Tree, toute aussi chargée en référence religieuse, est bien moins sombre que celle de Ka. La formule de Sunday School II reste la même que pour le précédent volume : des samples de soul pitchés, comme édités par une version crasseuse de No I.D., et calés sur des rythmiques trap. Le tout est porté par la voix de soulman, rocailleuse et saturée du rappeur, pour un style que ce dernier appelle « Soultrap ». Entre rap d’église et gospel de rue, Tree raconte Chicago, ses quartiers, ses habitants et sa tradition musicale. Tout dans Sunday School II, du grain des prods à la voix du rappeur, apparaît comme un interstice entre le beau et le laid : Tree embellît la pauvreté quand il la contemple et la raconte de sa voix éraillée, sali ses samples pour les rendre plus jolis et fait de son album un espèce de rayon de soleil dans les nuits glaciales de Chicago. Le projet trouve dans cet entre-deux toute sa cohérence, et rend pleinement compte de la personnalité toute en nuances de Tree, vieux routard du rap coincé entre la rue et l’église.
En ayant réglé le problème de mix/mastering et diversifié ses sonorités en faisant appel à d’autres producteurs (l’orgue boom-bap de « Safe to say », la rythmique de Bink! sur « Devotion » ou l’espèce de turbine synthétique sur « Busters »), Tree livre un album qui n’a peut-être pas les singles du premier volume, mais qui dans sa totalité est un bien meilleur projet.
Autre album pour partir à la rencontre de Dieu, indispensable ce semestre : Kanye West – Yeezus
Migos – Young Rich Niggas
Bando : diminutif d’ « abandonned house », soit une de ces maisons inhabitées dont les fenêtres ont été recouvertes de planches en bois et autres morceaux de cageots endommagés. Ce qu’il s’y passe ne nous regarde pas, et tant que leurs résidents continueront à nous abreuver en musique, on fera mine de ne pas savoir. Les derniers arrivés dans le business du squattage de bandos, tout le monde les connaît depuis que Drake a commis un remix de « Versace ». Avant ça, Migos étaient déjà un petit phénomène à Atlanta, à l’affiche d’une soirée, souvent en compagnie de Que, chaque soir de la semaine depuis un an.
Le titre qui les a lancé « Bando » est le résultat d’une enfance bercée par le rap d’Atlanta post-2005: Zaytoven, OJ Da Juiceman, Soulja Boy, Gucci Mane, Travis Porter, et Future. Aucune de ces figures locales n’ont travaillé sur ce titre, mais on y perçoit nettement l’influence de chacune.
Alors forcément, quand Yung LA est tombé sur le titre, il s’est empressé de le faire écouter à Zaytoven qui à son tour n’a pas hésité longtemps avant de prendre le trio sous son aile. Aujourd’hui Migos est devenu le chainon manquant entre OJ Da Juiceman et Future, et a arrive à se faire accepter avec un genre de rap qui était (en dehors d’Atlanta) encore trop souvent ignoré ou moqué il y a quelques années. En 2009 Juiceman se faisait huer à New York quand il venait performer « Early Morning », il y a quelques mois, TakeOff et Quavo, venus chanter « Versace », étaient reçus comme des princes au même endroit.
Plus discrète que les explosives « Versace » et « Hanna Montana », « R.I.P. » est en réalité une des chansons de rap les plus incroyables de ces derniers mois. A première vue complètement déstructurée, avec un assemblage qui peut sembler improvisé de phrases, syllabes, adlibs, accélérations ou petites onomatopées, on se rend rapidement compte que tout ce capharnaüm est précisément millimétré. Les Migos ne sont jamais célébrés pour leur technique, mais le feeling extra-terrestre qu’ils développent sur ce titre démontre qu’ils ne sont pas que des machines à gimmicks, et que leur divertissement est façonné avec un compas dans l’oreille.
Pour le reste, Migos c’est ça, du divertissement. Et tout est toujours utilisé dans l’optique de créer quelque chose de fun. Même le double-temps, que les rappeurs utilisent trop souvent pour des démonstrations un peu creuses de technique, ne sert ici qu’à faire danser.
Gucci Mane – Trap House III
Comme à chaque saison de rap depuis presque une décennie, le saint patron des bandos revient avec une fournée de psaumes. Essayons de sortir des questions ressassées à chacune de ses sorties, mythes et légendes sur son retour ou sa déchéance, interrogations sur les étapes de sa carrière ou sur l’état mental dans lequel il se trouve, pour simplement voir ce que cet album a dans le bidon.
Trap House III est loin d’être parfait, avec quelques titres qui se ressemblent trop et d’autres qu’on à l’impression d’avoir déjà entendu. Mais dans son hyper productivité, Gucci Mane continue de tailler quelques perles et d’explorer de nouvelles choses. Confirmation de ce que laissait entendre « Scholar » sur Trap God II, Gucci s’est mis à l’émotion et l’introspection, peut-être même teintées d’une pointe de regret ? Il a su parfaitement retranscrire tout cela en musique, notamment en intégrant des petits climax émotionnels à ses chansons, des moments fugaces où la mélodie et sa voix change légèrement, nous faisant souhaiter que toute la chanson ait été comme ça – Il y avait cette lente montée en puissance dans « Scholar », jusqu’à son refrain qui n’explose jamais vraiment, il y a maintenant le dernier couplet de « Hell Yes » où Gucci fait sa déclaration d’amour d’une envolée Auto-Tunée en Alexandrin, qu’il rappe à coup sûr les yeux fermés. Aussi une chanson d’amour « Point of my life » est le deuxième moment fort du disque, produit par un Dun Deal qui est allé chercher des guitares country pour offrir à Gucci Mane sa première ballade romantique. Et quand il faut faire ce qu’il fait de mieux, du rap lourd, lent et puissant, le Trap God continue de dérouler. Surtout quand il est servit par les bass crunk et les synthés de cimetières de Drumma Boy (« Dipped In Gold » ; « Nobody »).
Pour animer sa maison piège ces derniers mois, il ne fallait pas passer à côté de : Doe Boy – Baby Je$us
– OUTRO –
Tout récemment, trois des cinq meilleurs rappeurs en activité ont sorti des projets, ça n’a pas été reprécisé, mais il fallait aussi, évidemment et avant tout, écouter Gunplay (Acquitted), Starlito (Cold Turkey) et Kevin Gates (Stranger Than Fiction).
Le mois prochain l’album de Brick Squad, le retour de Young Scooter et la triplette Gucci Mane pour qu’il soit 10H17 toute la journée et toute la semaine.
Fat Trel et Shy Glizzy seront aussi de retour pour montrer ce que D.C. a dans le ventre, et le messie Earl sort enfin son deuxième album.
En attendant la prochaine saison de rap, restons sur ce cliffhanger digne d’une fin de saison des Jeux du Throne : Chief Keef, qui continue sa transformation en entité cybernétique, dessine les contours du rap de demain. Il a définitivement pris la pilule rouge, et le voilà libéré du joug des Illuminatis et des normes de l’exploiteur. Si vous n’y arrivez pas encore, c’est sans doute parce que vous êtes toujours reliés à une machine qui se nourri de vos excréments et des protéines de votre cerveau. Chief Keef est le lapin blanc, mon Dieu, laisser le glapire à l’auto-tune sur toutes les productions de Yeezus pour que nous soyons libérés de la matrice. « Almighty So » devrait sortir avant la fin de l’année.