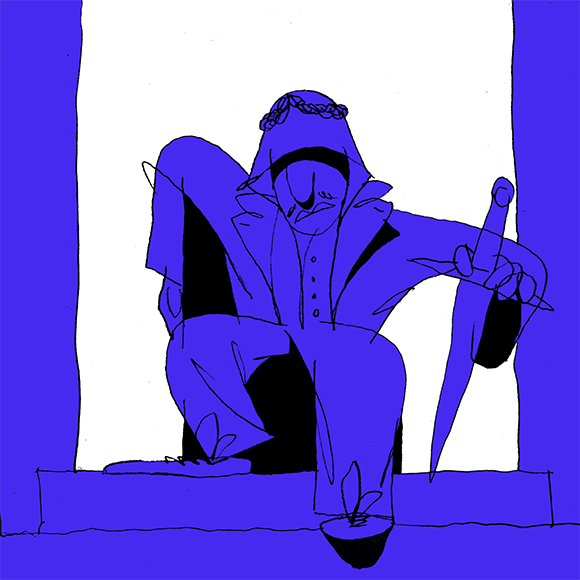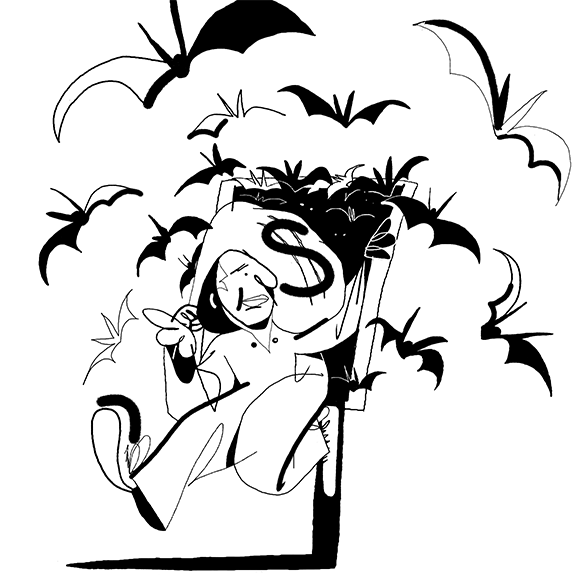… à 03 minutes et 03 secondes de Praying to God, 03 Greedo flotte au dessus d’une production vidée de ses rythmiques et touche du doigt le God Level. Les espaces remplis par les oscillations d’auto tune, l’air moitié braillé moitié marmonné, créent un effet d’abandon, d’une émotion accrue et écrue malgré les vocalises de la machine. Sa lévitation est stoppée de façon abrupte et ces presque 30 secondes ressemblent à sa trajectoire, faite de moments de grâces perdus au milieu du brouhaha, et d’une sensation d’inachevé en guise d’apothéose.
03 Greedo tâtonne pour atteindre ce genre de moment, il cherche en permanence la bonne séquence chiffrée en triturant ses notes, l’oreille accolée à la porte en métal d’un coffre fort contenant le fameux « God Level » – cet instant de quiétude spirituel indispensable pour supporter la vingt-cinquième heure.
Avec son premier album Purple Summer, on a déjà tendance à le réduire à la musique émotive, en retenant l’élégiaque Mafia Business, ses pistes vocales superposées et son mix qui fait planer la mélodie comme un chœur gospel. Un an plus tard, First Night Out capture cette essence sous une patine céleste faite de filtres métalliques et d’un écho rappelant l’acoustique des halls d’aéroport.
Sur God Level, c’est Floating qui fait illusion de synthèse. Les 30 dernières secondes de Praying to God y sont tenues pendant plus de cinq minutes, l’extase se mêle à la tristesse et on entend cet accouplement de Californie et de Louisiane qui engendre des difformités comme 03 Greedo. Mais cela ne suffit pas à décrire sa musique. Tout au plus, ce n’est qu’une porte d’entrée parmi d’autres, un moyen de s’immerger dans un album polymorphe, dont l’un des multiples styles finit par piquer pour que les autres prennent comme un venin.

Sur les pulsations de Fortnite, les rues de Watts apparaissent dans les jeux de construction de sa fille alors que des percussions et des armes entrent en scène ensemble. On ne sait plus s’il chante sa vie ou si elle n’est qu’un immense freestyle. Les images superposées galvanisent, et permettent d’imaginer comment Greedo travaille, enregistrant en permanence ce qui encombre sa tête.
Ses qualités comme ses défauts sont inhérents à cette manière de faire. L’album est gargantuesque, avec des temps faibles qui entachent certaines chansons quand elles sont prises seules. Mais en l’écoutant comme elle a été faite, immergé dans cette cascade discontinue et insaisissable, la musique de Greedo prend toute sa mesure. Les banalités s’atténuent et les moments où il trouve le « God Level » deviennent des récompenses encore plus fortes.
En se laissant porter par ce flux désordonné on apprécie d’avantage sa polyvalence, la fluidité avec laquelle il passe de la nervous music sinistre à la fraicheur du Rich Gang, sans compartimenter les styles et les personnalités. Pour être à la fois maniaque et crooner, Greedo se love dans les dissonances, ne corrige pas les aspérités et les faussetés, même sur ses titres à priori les plus pop. L’ensemble tient dans ce déséquilibre, exprimé aussi dans le décalage entre les mélodies faciles et sa voix perçante gonflée d’hélium.
Pendant que s’active l’horlogerie trap de Kenny Beats, Greedo laisse aller son excentricité et son humour le plus absurde. Il y a les sismiques Basehead et Street Life, puis In My Feelings et Conscience, qui avec leurs airs enjoués font parties de ces moments de pureté ponctuant l’album, qui, malgré tout, lui donne sa teinte globalement joyeuse.

Sur Finally, le loup de Grape Street court en énumérant tout ce qu’il possède enfin. Malheureusement, le contexte nous force à comprendre qu’au bout du sprint tout sera perdu. Sa course, qui commence avec un procès et se termine par une longue peine, fait de God Level un contre-la-montre qui brouille les émotions.
Quand les basses et les caisses claires se taisent au milieu de Bacc to Jail, laissant Greedo fredonner seul son blues cybernétique, les questions qu’il se pose deviennent déchirantes, et réveillent les mauvais souvenirs du I Never Wanna Go Back enregistré par Max B avant de se rendre à la police.
L’atmosphère est particulièrement sombre sur les chansons comme Mr. Clean ou Gun Bucc qui traitent d’autres sujets, de drogues ou de crimes violents. Mais ce sont celles qui célèbrent joyeusement la famille et l’amour, ou évoquent les moments de plénitude, qui sont de loin les plus tristes… à cause de cette ombre planant sur les sourires d’03 Greedo.
illustrations : Ivan Lavague