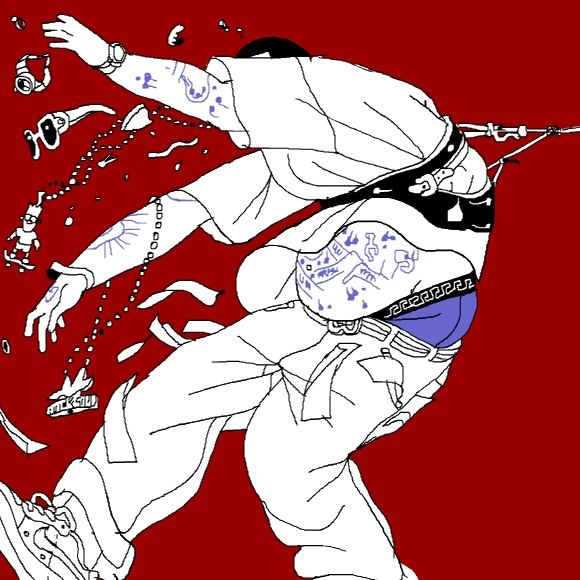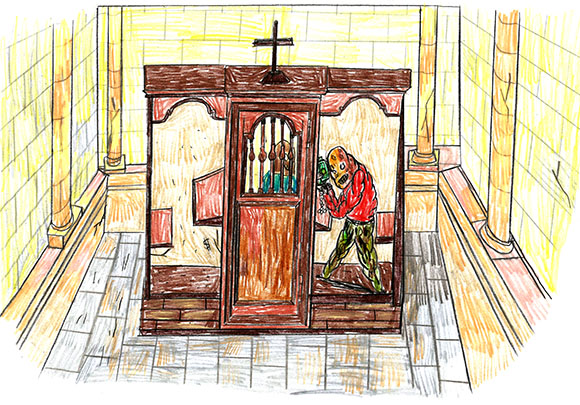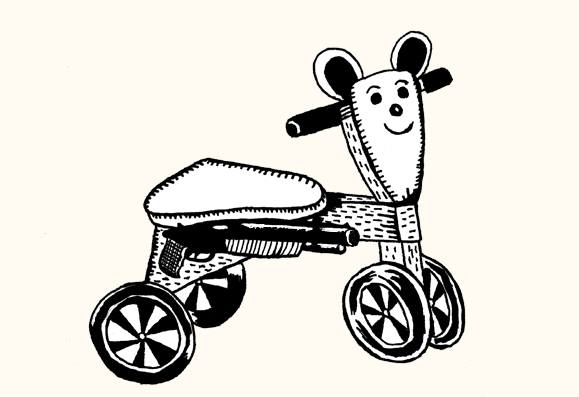
Lil Herb, Welcome To Fazoland
C’est aussi bien de la Sparte antique que de villages dévastés par la guerre de Cent Ans dont il pourrait être question sur Welcome To Fazoland. On y croise des bébés qui font ce qu’ils peuvent pour nourrir leurs bébés, des enfants anesthésiant la peur avec des drogues, capables de toutes les horreurs nécessaires à leur survie et accumulant l’argent comme on stock des vivres avant l’apocalypse zombie. Pourtant c’est de Chicago dont il s’agit, une ville américaine contemporaine et bien réelle. Comme si ces scènes de fin du monde ne suffisaient pas, le choix impeccable des prods renforce l’ambiance glaciale et quasi moyenâgeuse. Samples héroïques, basses tapées comme des tambours de guerre, et quelques respirations soul ou menées par des chants pitchés pour souffler entre deux batailles pour le Throne de Fer.
En dehors des rappeurs, tous les personnages cités sont morts ou utilisés comme simples éléments de décors anonymes. Et parce qu’il donne plus d’importance à la description et aux formes que beaucoup de jeunes rappeurs locaux d’avantage dans le gimmick, l’attitude et l’énergie cathartique, Lil Herb fait enfin apparaître quelque chose qui a toujours été sous-jacent dans l’univers de la scène « drill » : l’absence totale d’adultes dans cette cité d’enfants perdus. Au quotidien jamais un parent n’apparaît, et s’ils sont évoqués, ce n’est que comme des personnes quittés avant un départ en guerre. Mamma I’m Sorry, sur lequel Lil Herb s’adresse à sa mère comme s’il l’avait abandonnée pour rejoindre la rue, est certainement le moment fort de la mixtape.
La dure réalité de Welcome To Fazoland serait difficilement supportable si les productions, encore une fois impeccables, et l’impressionnante technique de Lil Herb n’étaient pas là pour la sublimer. Rapide et extra fluide, le flow du gamin vous prendra par les trips dès les premières secondes, pour vous faire traverser sa ville et son univers en spectateur effrayé, mais forcément conquis par la qualité de la musique.
Young Thug & Bloody Jay, Black Portland
A cause du décalage horaire entre les gouffres et les clubs où trainent Drake et Kanye West, les morceaux de rap les plus discutés de ce début 2014 sont deux singles de Young Thug datés de l’an dernier. A propos de Danny Glover (et de Stoner), une des choses qui revient le plus souvent c’est cette réaction physique créée par la musique, ces espèces de tics nerveux, grimaces et crispations que transmet Young Thug quand on l’écoute. Son rap s’agrippe tellement à nos instincts que même des pop stars, pourtant soucieuses de leurs apparences, ne retiennent pas les animaux enfouis en eux quand Thugga surgit en soirée pour se gargariser avec l’autotune ou nous jurer qu’il est la réincarnation de vieilles gloires d’Atlanta.
On le compare beaucoup à Lil’Wayne, pour plein de vraies bonnes raisons, mais autant dans son propre feeling que dans ce qu’il transmet physiquement à l’auditeur avec sa musique, il y a aussi beaucoup de Mystikal dans l’ADN de Young Thug.
Pour ça, si l’info venait à être confirmée, son rapprochement avec les artistes Cash Money pourrait être une bonne idée.
Sur Florida Water Young Thug calme juste assez ses envolées épileptiques pour laisser de la place à d’autres de ses points forts, moins remarqués : un sens de la mélodie et des lyrics, aux choix absurdes ou poétiques, qui semblent avoir été écrits dans un état alternatif que seuls Lil’Wayne et Gucci Mane ont connu avant lui. Sur ce genre de morceaux, Young Thug rappelle surtout que s’il fallait vraiment le situer dans le vaste champ des sous genres ATLien, ce serait vers les ringtones du Swag Rap qu’il faudrait le rapprocher… et non pas vers la Trap Music.
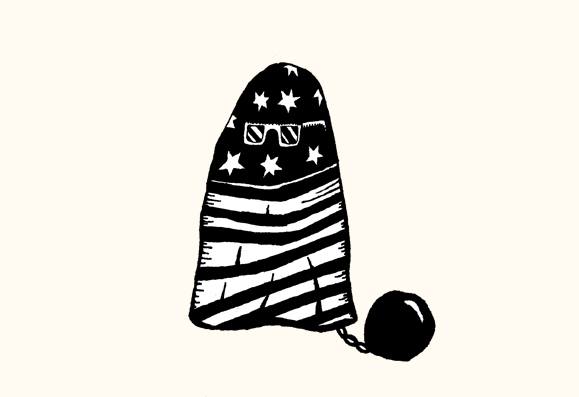
Young Scooter, Street Lottery II
Pendant ce temps Young Scooter poursuit ce qu’il a entamé l’an dernier. Et d’une certaine manière, quelques chansons du bras droit de Future provoquent aussi une sorte de réaction physique : une irrémédiable envie d’effectuer un signe de croix quand débutent certains couplets. C’est intéressant comme Young Scooter lui-même n’arrive pas à entendre ce qu’il fait réellement comme musique. Il répète que c’est de la Count Music, soit des shots de motivation pour compter ses billets, mais il y a tellement plus que ça. Il y a quelque chose de quasi-religieux dans certains titres, montés comme des fables bibliques. What Happened To Me, de loin la meilleure chanson de son dernier projet, en est l’exemple parfait. Le Trap Jesus y parle de sa vie de dealer comme d’un sacerdoce, porte le poids de ses choix comme Jesus, le vrai, portait sa croix. En un seul texte, Scooter aborde absolument tous les thèmes centraux de la trap music, et comme personne ne l’avait fait depuis Young Jeezy il y a dix ans. Les conséquences irréversibles d’embrasser une telle vie, l’impossibilité de s’en réchapper, la compétition effrénée, la course à l’argent déraisonnée, les signes extérieurs de richesses qui se multiplient et qu’il faut sans cesse pouvoir justifier… A chaque fois il suffit d’une seule phrase très courte à Scooter pour dire quelque chose qui plante une image avec une profondeur de champ infini. Et de la façon dont ils traitent les autres, il renforce l’impression d’être un être à part, quasi divin. Il renvoie d’un côté les mauvais, qu’il accuse d’avoir péché (« too greedy« ) ou de prêcher le faux (« they misguided you« ), de l’autre les bons, à qui il montre du respect tout en précisant quand même qu’il les toise depuis le ciel (« Salute Ross, Birdman, Gucci, but I got more bricks…« ).
« I can’t go home, I gotta keep grinding, keep hustling… »
Après écoute du morceau on peut vraiment avoir l’impression que Young Scooter nous a « délivré un message » comme il dit. Jusque là les trappeurs nous auraient poussé à devenir téméraire, alors Scooter prône une trap réfléchis, plus spirituelle et laborieuse. Encore une fois, le Black Migo apparaît comme un fantôme des pionniers américains et de l’éthique protestante sur laquelle se sont bâtis les USA, les différences venant seulement du fait que les hommes à qui il s’adresse ont remplacé leur pioches et leurs pépites d’or par des fourchettes et des cailloux de crack. Et le jeune producteur Metro Boomin parachève cette cathédrale en habillant des choeurs avec des cloches et le cliquettement de quelques gouttes d’eau bénite.
Il fallait aussi écouter : Stu Hustlah & Lil Juu, Lilie Street Is The Street ; Tree, The MCTREEG EP ; Shy Glizzy, Young Jeffe ; ScHoolboy Q, Oxymoron ; Pyramid Vritra, Indra