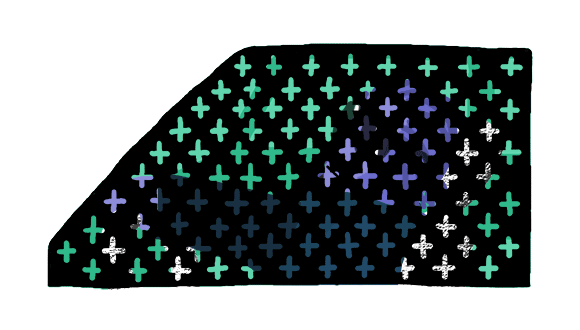tags:

Avocat le jour, Matt Murdock devient le super héros Daredevil aussitôt la nuit tombée sur New York et son masque à cornes rouges enfilé sur le crâne. Son alter ego lui permet au moins trois choses. D’abord, de séparer sa personnalité et sa vie en deux. Ensuite, de protéger incognito Hell’s Kitchen, son quartier de Manhattan qu’il chéri comme une mère. Enfin, cela l’aide à libérer une part d’ombre sommeillant en lui, incompatible avec la vie diurne et normale à laquelle aspire Murdock. En suivant le comics Daredevil de page en page, on est trainé dans la crasse d’Hell’s Kitchen autant que dans la psyché tourmentée du héros aveugle de Marvel. Ses histoires à la voix narrative, comme si nous entendions sa conscience parler, font échos à ce que raconte la musique du rappeur Ka. Et vice versa.
Le jour, Kaseem Ryan serait un pompier de New York. C’est en tout cas ce que l’on raconte, lui n’ayant jamais confirmé (ni infirmé) l’information. Son alter ego ne prend vie qu’une fois la ville plongée dans le noir, à en croire l’ambiance de ses clips et des photos prises et affichées sur son blog. Pour devenir Ka, il n’enfile pas de masque mais écrit sur son territoire, le quartier de Brownsville à Brooklyn, dont il est une sorte de conteur et d’ange gardien.
Le pouvoir de Ka, c’est d’arriver à décrire et raconter le Brooklyn de la « Crack Era » trente ans après, mais de manière assez vive pour laisser croire que cela se passe aujourd’hui. Dans les années 80, Kaseem a vu les sols de Brownsville se fissurer pour laisser échapper des humains à moitié morts, amaigris et rongés par le crack. « J’ai vu des Zombies, confie-t-il, des sols jonchés de matériels d’injection. J’entendais des coups de feu et des gens mourir chaque soir. » C’est là où s’arrête le parallèle avec Daredevil : Ka n’a pas perdu l’usage de ses yeux et est forcé d’observer Brownsville tomber dans la décadence. En grandissant dans cette petite bulle d’enfer sur terre, Kaseem raconte qu’il est courant d’avoir eu un revolver entre les mains avant 12 ans, que l’ont voit ses voisins dépérir sans pouvoir intervenir, quand on n’est pas simplement forcé de les voler pour survivre. « Nous n’étions pas des mauvaises personnes, juste affamés. C’est la faim qui pousse à faire ce genre de choses. »
Un Crime Dans La Tête

Son dernier album Days With Dr. Yen Lo débute par un supplice. « Blood, Blood, Blood… » du sang coule de la pointe d’un stylo et tombe au compte goutte sur le front de l’auditeur. On peut y voir une métaphore du style de Ka, qui s’est toujours efforcé de faire ressentir dans son écriture à quelle point il est habité par des choses qu’il aurait préféré ne pas connaître. « Je saigne dans mes chansons, parce qu’elles sont des extensions de moi-même. » Mais c’est aussi une référence aux tortures et manipulations psychologiques de celui qui donne son nom à l’album. Le Dr. Yen Lo est le savant fou Chinois du film The Manchurian Candidate, celui qui hypnotise Frank Sinatra et Laurence Harvey pendant la Guerre de Corée, afin de les transformer en assassins.
C’est encore Brownsville qui sert de décors à ce nouvel album. Days With… est un récit Noir sur New York, où ses rues sont évoquées à travers des contes funestes, des emmêlements de symboles et un labyrinthe de longues métaphores filées. On suit la voix de Ka, à priori poursuivi par la police, traversant des rues sèches comme un désert, pour décrire les conséquences d’une course à la fierté et aux richesses matérielles. Si les interludes, tirées du film qui inspire le thème de l’album, laissent entendre que quelqu’un subit un lavage de cerveau, on ne comprend qu’à la toute fin que les victimes potentielles ne sont autre que l’auditeur et les personnages de Ka : endoctrinés par une force invisible, ils ont été placés sur la ligne de départ d’une spirale menant au crime, à l’auto destruction et finalement, à la pauvreté dans toutes ses formes. Avec le titre Day 777, c’est aussi le rap qui est désigné victime de cette lobotomie, quand il se polit, se conforme, pour s’adapter à un moule qui le mène à sa perte. Quant à Ka, il conclue que si lui est toujours debout (dans la vie et dans son art) c’est certainement signe d’une élection divine.
Les textes complexes, faits de doubles voire de triples sens, rendent impossible la compréhension de chaque ligne à la première écoute. Ils font de Days With Dr. Yen Lo une sorte de manuel à décoder, d’autant plus qu’il est construit comme un journal dont les pages ne suivent pas l’ordre chronologique. Le travail d’écriture de cet album est, encore une fois avec Ka, hallucinant. Absolument chaque ligne prise à part reste lourde de sens, tout en ayant une place qui semble pensée à la fois dans le contexte de la chanson, et dans tout le storytelling de l’album. « Picasso ne pointe pas ses peintures en disant ‘yo, là c’est un taureau, là c’est un femme’. Je ne ferai pas ça non plus. Tu vois un taureau là ? Bien. Tu vois une femme ? Bien ! Ne me demandez pas d’expliquer ce que j’ai dessiné. » Et chacun reste libre de décrypter les symboles et allusions du Dr. comme bon le lui semble.
Ka donne du poids à chacun de ses mots grâce à son flow proche de la conversation, parfois presque chuchoté, comme s’il rappait avec la peur d’être entendu par quelque chose qui rôde. « Mon frère Ka rappe comme un prophète sur le sommet d’une montagne » dit Roc Marciano, et c’est vrai que l’impression d’entendre le prêcheur d’un culte hérétique est permanente. Par le passé, le flow sombre de Ka a pu faire penser à celui d’un cousin insomniaque de MF Doom ou Prodigy. Sur cet album, les variations et les harmonies chantonnées ou marmonnées rappellent parfois Raekwon, plus souvent Max B. En attendant Ice Cream Man de son partenaire Roc Marciano, l’évidence était devenue claire pour tout le monde, Biggavelli est partout dans le rap de Roc Marci, et sur Days With… on commence à en trouver quelques éclaboussures chez Ka.
Days With Dr. Yen Lo est en réalité un album en duo. Il est entièrement produit par Preservation, DJ et beatmaker, notamment pour Mos Def, et avec qui Ka avait déjà travaillé sur le EP 1200 B.C. l’année dernière. Le travail de Preservation complète et accompagne parfaitement les textes de Ka. Ses jeux sur les espaces et les silences pour créer des mouvements font osciller l’ambiance entre tension invisible et paranoïa. Le grain et les rythmes lents renforcent le côté suffocant du disque, pendant que ses samples précisément découpés de prog-rock des 70’s, nous replongent à l’époque des propagandes de la Guerre Froide. Preservation n’utilisent que très peu de boite à rythme, préférant avoir recours à des boucles d’instruments et rythmer ses productions avec des changements et superpositions de boucles. Encore une fois, c’est un choix qui nourrit la sensation d’oppression et l’aura mystérieuse dégagée par l’album.
Days With Dr. Yen Lo partage les qualités de The Night’s Gambit, précédent opus de Ka, la même écriture léchée et des drones atmosphériques en guise de production. « J’ai sorti Gambit pendant qu’on travaillait sur Yen Lo. Cet album était très influencé par le travail que j’entamais avec Preservation. » Mais cette fois, le concept global de l’album est poussé encore plus loin. C’est pourquoi Days With… est aussi un album opaque, qui n’accèdera jamais aux radios. Pourtant, et seul le temps permettra d’y voir un peu plus clair dans la brume du Dr. Yen Lo, il pourrait s’agir du meilleur album du héros de Brownsville. Une pierre de plus dans une discographie qui, avec quatre victoires pour quatre batailles menées, est sans conteste l’une des meilleures des années 2010.
Origines Secrètes

Les récentes réussites de Ka paraissent encore plus fortes quand elles sont replacées dans leur contexte, au bout de son parcours chaotique et de son éclosion tardive.
Ka a commencé le rap très jeune, tout juste après avoir entendu les premières rimes de Slick Rick au début des années 80. Sa carrière, on pourrait la résumer avec cette anecdote qu’il raconte souvent : au début des années 90, il se retrouve à un concert de celui qui deviendra bientôt une légende, The Notorious B.I.G. Le manager de ce dernier, Puff Daddy, harangue la foule et demande si quelqu’un se sent capable de défier son poulain dans un duel d’improvisation. Kaseem, persuadé de pouvoir rivaliser, lève la main, pour aussitôt se raviser.
Les hésitations et les rendez-vous manqués sont légions tout au long du parcours de Ka, heureusement sa famille et ses amis vont régulièrement lui remettre le pied à l’étrier. C’est un de ses cousins qui le présente à Mr. Voodoo, avec qui Ka et L Swift formeront le groupe Natural Elements. Les premières traces de Ka sur sillons se trouvent sur leur premier EP sorti en 1994 chez Fortress Records et produit par l’un des fondateurs du label, Charlemagne.
Mais dans la foulée, Kaseem quitte de lui-même le groupe, ne se jugeant pas au niveau des autres membres. Il est alors remplacé par A Butta et ne profitera pas de leur deal avec Tommy Boy Records. En 1998, il forme le duo Nightbreed avec son ami Kev, dit Oddbrawl. Epaulés par Charlemagne, ils sortiront le EP Two Roads Out The Ghetto, toujours chez Fortress Records, puis quelques singles et démos.
L’histoire de Ka aurait pu s’arrêter là. Malgré les démos envoyés aux labels, Nightbreed n’obtiendra jamais de contrat, et les deux amis finissent par lâcher l’affaire. Mais poussé par la passion et hanté par les vieux fantômes de Brownsville, Ka continue d’écrire et d’enregistrer des chansons dans son coin, même si rien ne sort, puisque rien ne le satisfait jamais complètement. Il dit avoir plusieurs milliers de chansons écrites à cette époque, stockées dans des disques durs ou confinées dans des cahiers de rimes.
L’air Giuliani, puis la crise des années 2000, n’aident pas à améliorer la situation à Brownsville. La présence policière s’accentue, comme les tensions, et « The ‘Ville » accueillent de plus en plus des gens chassés des quartiers alentours par la gentrification. Pour documenter une bonne fois pour toute la vie de son quartier, et remercier voisins, amis et famille qui l’ont porté et supporté jusqu’à présent, Ka se décide à sortir un album solo. En 2008, Iron Works est écrit comme un premier et un dernier disque, un adieu au rap.
Année Un
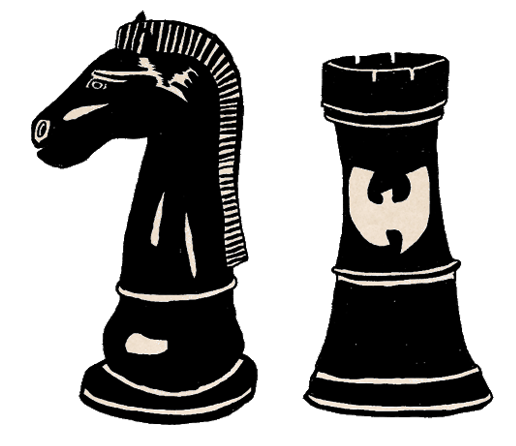
Quasi entièrement produit par un ami du Bronx surnommé Yanedus, Iron Works n’est tiré qu’à 1 000 exemplaires, que Ka offre à son entourage et à quiconque assez curieux pour l’écouter.
La magie du bouche à oreille fait le reste, jusqu’à ce matin où Ka reçoit un coup de fil de GZA. Impressionné par Iron Works, le membre du Wu-Tang veut inviter Ka sur son album solo. Quoi de mieux pour terminer sa carrière que de rapper une dernière fois avec une de ses idoles ? Le morceau Firehouse aurait pu être le dernier clou planté dans le cercueil de Ka, s’il n’avait pas aussi déclenché sa rencontre avec celui qui produit le morceau : Roc Marciano.
Comme à tout héros de comics, ce qu’il fallait à Ka, c’était peut-être un mentor. C’est le rôle que va jouer pour lui Roc Marciano. Celui qui s’apprête alors à sortir Marcberg, l’un des premiers classics new-yorkais des années 2010, se lie d’amitié avec Ka et le pousse à poursuivre dans le rap. Aussi bien dans l’écriture que dans la production d’ailleurs, en expliquant à son collègue de Brownsville que si lui y arrive en s’y étant mis par dépit, il n’y a pas de raison qu’il ne devienne pas aussi un producteur correct.
C’est ainsi que quatre ans plus tard, Grief Pedigree voit le jour. Entièrement produit par Ka, avec pour seul invité Roc Marci. Encore une fois, la tournée des labels reste infructueuse, alors l’album sort en total indépendance, avec un Ka au four et au moulin. Il écrit, produit, fait la pochette et se lance dans la réalisation de clips. Le premier single Cold Facts, pur jus de Ka avec sa boucle hypnotique et son joyau lâché par seconde, est aussi la première vidéo filmée et réalisée par le rappeur. Quelques tutoriaux YouTube, une utilisation tâtonnée de iMovie, et Ka se découvre un nouveau hobby. Sa femme lui offrira ensuite Final Cut Pro, et les morceaux de son album seront clippés un à un par le rappeur.
DAVAL and RYAN

Fatbeats était un magasin mythique du Lower East Side de Manhattan. Point de vente du premier projet de beaucoup de rappeurs new-yorkais et vrai lieu de rencontre pour toute une scène qui se formait en 1994. Aujourd’hui, le magasin est fermé, mais c’est à son ancien emplacement que Ka s’est symboliquement posté, un carton plein de disques à ses pieds, pour vendre lui-même son album. Très peu de gens sont venus lui acheter Grief Pedigree, mais un matin, un type débarqué du New Jersey prend un exemplaire, en expliquant que c’est par Mos Def qu’il a entendu parler de Ka. Cet homme, DJ et producteur pour celui qui se fait maintenant appeler Yasiin Bey, c’est Preservation. Une rencontre qui donnera naissance quelques années plus tard au EP 12 000 B.C. et à l’album Days With Dr. Yen Lo. Parce qu’un super héros a aussi besoin d’un sidekick…
« Je ne suis pas un génie. J’ai dû travailler dur pour devenir bon. » Pour faire une musique pleine de flashbacks, de regrets et de réflexions sur le passé, il fallait bien que l’âme de Ka vieillisse un peu. En racontant sans fierté son passé de criminel qui en a trop vu, en nous faisant parcourir les allées les plus sombres du Brownsville d’hier et d’aujourd’hui, il prêche pour une forme de repentir et réalise un petit miracle dans le milieu très jeuniste du rap : être mature, sans en faire un postulat ou chercher à donner une leçon.
De Grief Pedigree à Days With… en passant par Night’s Gambit, ses textes denses et à tiroirs ont tantôt transformé Brooklyn en no man’s land, tantôt donné vie à ses murs et à ses nuits. Entre rêves perdus de richesse, course à la survie et contre les circonstances, questionnements moraux et références cinématographiques pointues, le rap de Ka est celui d’un personnage complexe et d’un véritable auteur. C’est aussi une esthétique léchées, avec des choix de productions forts afin d’avoir une véritable patte sonore, notamment en n’utilisant que très peu de boites à rythmes. Les basses et caisses claires peuvent être remplacées par des bruitages sourds et menaçants, comme les mécanismes d’horloges d’Our Father, qui semblent provenir de la boite crânienne en ébullition du rappeur. Des ambiances pesantes qui donnent l’impression de nous faire porter, avec Ka, le monde sur nos épaules, et épousent parfaitement son flow et l’univers dessiné par ses textes. En résumé, Ka est la preuve que l’on peut avoir la quarantaine, suivre les canons du rap des années 90, tout en continuant à expérimenter et à proposer une musique innovante et personnelle.
« La musique, c’est mon échappatoire, ma thérapie. J’en ai besoin pour rester sain d’esprit. Ca me permet de me débarrasser de ces images noires qui m’encombrent la mémoire. Je ne fais pas ça juste pour que ce soit fait, je le fais parce que j’ai besoin de le faire. »
illustrations : Hector de la Vallée