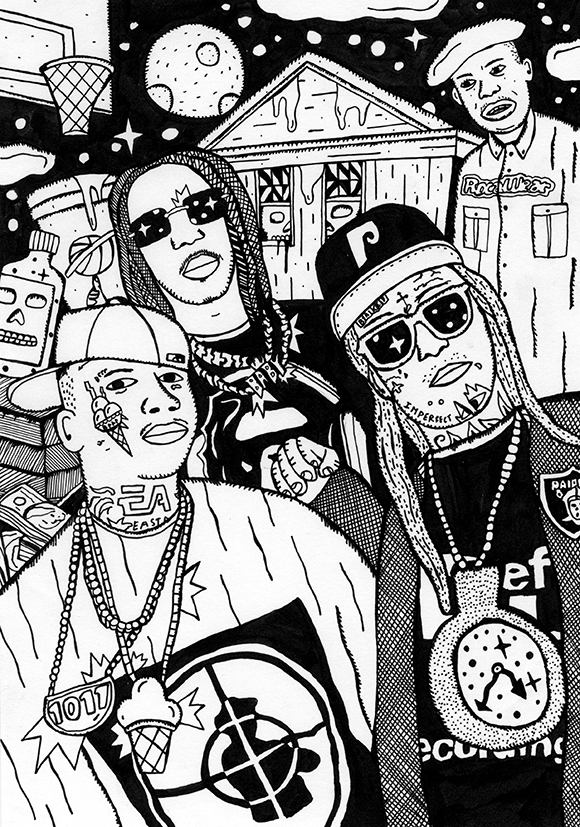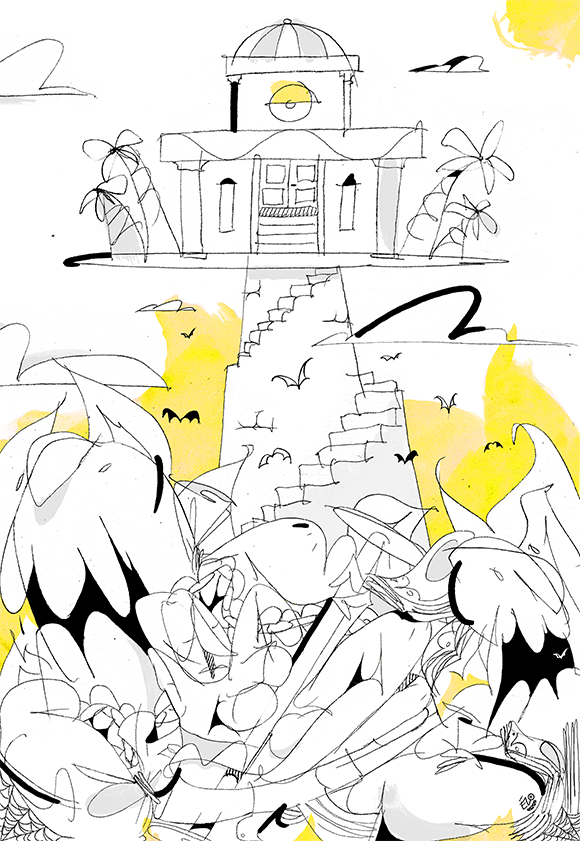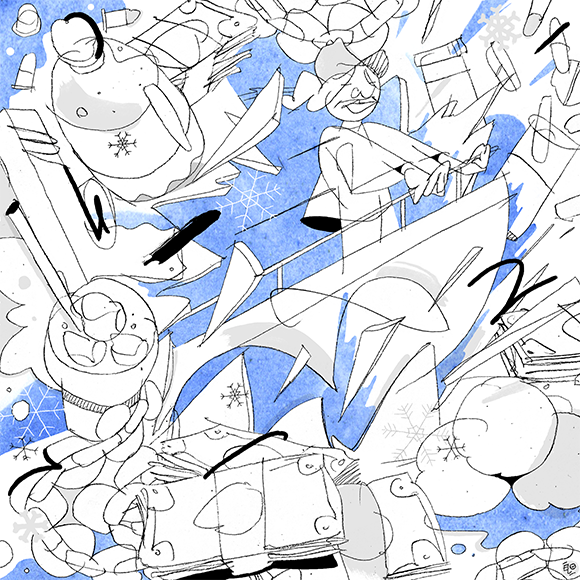Bandgang Lonnie Bands, Scorpion Eyes
Lonnie remonte l’histoire de sa vie pour retourner à l’origine de ses souffrances et conclut, au bout de l’introversion, que la malédiction précède sa naissance. « Nous sommes nés avec un stress post-traumatique ». Déstabilisante mise à nue, frontale et sans détour, Scorpion Eyes est un reflet difforme de Me Against The World. Les cloches de la vierge Marie y ont des airs de cowbells de Louisiane, mais l’espèce de lucidité fiévreuse perlée de frissons paranoïaques est restée la même, celle qui reliait déjà Tupac à B.G. et qui maintenant mène jusque dans le Michigan. Scorpion Eyes est le meilleur album de Détroit depuis Manger On McNichols du faux jumeau Boldy James, l’autre créature, devenue elle aussi insensible et amorale au contact des eaux profondes de l’Erié.
billy woods, Aethiopes
Construit sur des extraits de Kongi’s Harvest, un film écrit par le poète nigérian Wole Soyinka, Aethiopes est l’occasion pour billy woods de lier sa biographie à l’histoire de tous les afro-descendants. En retissant le vécu commun des Noirs, il raconte d’abord son propre parcours nomade entre le Zimbabwe et New-York, fuyant autant ses voisins criminels de guerre que son père révolutionnaire. Porté par un flot de signes dont les contours laissent une impression de sens partiel, le propos semble plus poétique que didactique, mais les détails biographiques comme le fond de son engagement finissent toujours par apparaître. L’esprit amer est insufflé dès ce tableau de Rembrandt utilisé comme pochette de l’album : représentation de Noirs libres dans l’Europe du XVIIème siècle, Two African Men montre que les Blancs n’étaient pas le seul sujet de l’âge d’or de la peinture hollandaise. Cette oeuvre, commandée par un colon enrichi grâce au commerce triangulaire, rappelle surtout que cette fascination pour l’autre est l’expression d’un racisme qui a servi à justifier le pire, que l’exotisme bienveillant, cherché ici comme dans d’autres oeuvres d’hier comme d’aujourd’hui, n’est guère qu’un synonyme du n-word.
Earl Sweatshirt, Sick!
Earl souhaite guérir d’un mal qui se glisse dans et entre les lignes, comme un serpent. La fois où ce mal se matérialise le plus clairement est certainement sous la forme d’une lessive, que Malcolm Little a un jour utilisée pour lisser ses cheveux, jusqu’à risquer de faire fondre son crâne. Le plus souvent, il se dissimule dans la poétique d’un croissant de lune ou de la météo d’une zone de montagne, derrière des métaphores à tiroirs ou difficiles à pénétrer. Sur Some Rap Songs les boucles étaient volontairement cassées pour laisser dans l’attente d’une résolution qui n’arrive pas, pour créer l’impression d’un brouillard qui empêche d’entrevoir la sortie. Sur SICK!, elles sont résolues, procurent un sentiment de complétude et d’aboutissement, qui accueille au plus près. On pourrait croire qu’Earl fait un pas en direction du monde, s’il n’ajoutait pas qu’il crache à la gueule de ceux qui le regarde. Mais Sick! se conclue sur un épilogue définitivement optimiste, sur le réconfort d’une existence banale, faites de textos laissés en vu et d’envie d’aller mieux, en attendant qu’ensemble nous sortions du donjon comme OutKast, pour que les notes de piano terminant Fire In The Hole deviennent la mélodie de tous les déconfinements.
Babyface Ray, FACE Deluxe
Le sens du mot wavy est fluctuant, mais dans le lexique de Babyface Ray il est d’une clarté minérale. Il renvoie à l’écoulement laminaire de son rap, une carpe capable de remonter n’importe quel courant, de glisser à la surface de n’importe quelle production sans aucun frottement, d’en épouser instinctivement chaque flux et reflux. Quand toutes les eaux convergent cela donne Sincerely face, morceau définitif de Babyface Ray, et archétype suprême de ce que l’on entend aujourd’hui quand on parle du rap de Détroit : Un sous texte paranoïaque couvert d’arrogance et de menaces, un homme encerclé par un néant neigeux et une atmosphère pesante, désolante, mais sans qu’il n’y ait de malaise – parce que Face et son flow sont exagérément à l’aise. Alors que nous nous sentirions à l’étroit, écrasés par la rigidité polaire du son, eux s’y fondent, se jouent de ce groove tout en raideur en le narguant avec des changements de cadence faciles et permanents. Sa musique est devenue plus expansive à force de gagner en intériorité, mais c’est de ce paradoxe qu’elle tire un peu de sa poésie. Babyface Ray continue de chercher l’exaltation du gain et du perfectionnement mais garde un œil tourné vers un hors-champ océanique, comme s’il souhaitait s’extraire du bocal d’acier dans lequel il est pourtant comme un poisson dans l’eau.
Rio Da Yung OG, Fiend Lives Matter
La manière dont ses lignes, toujours dites de manière identique, s’allongent sur leurs dernières syllabes ou se découpent pour presque se superposer, donne la sensation qu’elles s’enchaînent avec réparti. Ses idioties sont fascinantes parce qu’elles ont quelque chose de malin, et malgré l’imprécision technique et la monotonie, finissent toujours par tout emporter parce qu’elles ne s’arrêtent jamais, comme une bonne grosse coulante de rhinocéros. Dans la lignée de Life Of, l’humeur habituelle de Rio est parfois mêlée d’une nostalgie et d’une mélancolie liée aux événements de sa vie personnelle. Techniquement sorti en fin d’année dernière, Fiend Lives Matter est une énième preuve que Rio était voué à être l’une des locomotives du gangsta rap des années à venir, avec Drakeo The Ruler et 03 Greedo. Aujourd’hui, aucun des trois n’est en mesure de devenir ce qu’il aurait dû être et, même si c’est tout à fait secondaire, cela explique, peut-être et en partie, le relatif manque de génie de cette partie du rap, habituellement la plus vivante et passionnante à suivre.
RX Papi, First Week Out / Dope Deals 2
Le rap automatique et engloutissant de RX Papi, qui comme toujours va de pair avec une productivité gargantuesque, est un héritage de Lil B, dont il est, sous bien des aspects, un descendant direct. Dans sa manière de rugir ou de chanter en râlant, on entend aussi Chief Keef et ses mélodies, pour une autre inspiration finalement peu surprenante pour un rappeur de sa génération. Ce qui, entre autres choses, le différencie de la masse, est ce qui le rapproche de rappeurs new yorkais comme les Diplomats ou, surtout, Max B : un supplément d’âme insaisissable qui brouille sans cesse le ressenti des chansons, qui souvent dégagent une ambiguïté affective, faisant coexister la joie et une sensation de tristesse, le sérieux et l’absurde. Il n’est pas passé loin d’être le quatrième membre du carré maudit formé avec Greedo, Drakeo et Rio, mais finalement sorti de prison, Papi, dont l’aura ne cesse de croître, va pouvoir devenir le prince tragi-comique de 2023. Sur First Week Out, il enchaîne déjà les relectures paranoïaques de Citgo, la gangsta bounce de pilote de tank et la drill romantique, comme seule une future légende, biberonnée aux exploits de Wavy Crockett, en est capable.
Kodak Black, Back For Everything
Sans pour autant atteindre les sommets de 2017 – 2018, Kodak Black est redevenu lui-même ces derniers temps. Il retrouve progressivement son sens de la note bleue, sa capacité à faire basculer l’émotion d’une chanson d’un seul souvenir, son talent pour raconter la déchéance de ses personnages et l’irruption progressive du mal. Mais ce n’est même pas cela que sont venus chercher Future, Gunna, Kendrick Lamar, French Montana, et les quelques autres artistes majeurs à l’avoir invité pour, strictement à chaque fois, obtenir la meilleure chanson de leur album respectif : ce qui fascine aussi, c’est la capacité de ce diable montée sur ressorts à écrire des tubes efficaces et populaires comme Usain Boo ou Super Gremlin.
Valee, VACABULAREE
Le style neutre de Valee permet de mieux s’accrocher à ses mots, dont le côté absurde, énigmatique ou paradoxal crée une écoute concentrée. Ses courtes phrases en forme d’anecdotes se rapprochent alors des aphorismes chinois ne sollicitant pas la logique ordinaire. L’impression de détachement vient aussi des comparaisons utilisées pour décrire des lieux communs du rap. Comme un pas de côté fait à la fin d’une affirmation banale, elles enlèvent tout le sérieux que lui auraient donné d’autres rappeurs matérialistes. Mais plus que l’absurde, ce sont la légèreté et la sérénité qui restent, parce que cet art de la mesure se retrouve autant dans le choix des mots que dans la manière dont ils sont prononcés. Comme son titre l’indique VACABULAREE repose sur cette science du lexique, Valee abandonne les flows gymnastiques à la Two 16’s pour se concentrer sur ses césures laissant une sensation d’évanescence, voire de plénitude béate face aux objets, en même temps qu’un effet comique.
RXK Nephew, YouTube
La chaîne YouTube d’RXK Nephew est alimentée littéralement en permanence d’un torrent de titres, et son oeuvre ne s’apprécie vraiment qu’une fois plongé entièrement dans ce qui n’est rien d’autre qu’un abîme insondable de paranoïa et de complotisme, de flash backs de deals et de souvenirs d’enfance malheureux, de farce de looney toons et de méchanceté gratuite. Le freestyle American TTerrorist, le I’m God de la post-vérité, restera pour toujours son chef d’oeuvre indépassable, et la meilleure porte d’entrée pour son lobe temporal, mais cette année, pour qui aurait encore besoin d’un album pour découvrir un rappeur, Universal Slither condense autant que possible son indomptable et aléatoire mélange d’horror-cloud-trap-drill-plugg-bounce rap.
Young Nudy, EA Monster
La musique de Nudy est pleine de basses aux rebonds saturés, de montages d’éléments dissonants et de compositions bizarres, d’échos de guitares wawa qui donnent un effet de vertige dans le son, comme l’impression de respirer des bouffées délirantes ou d’être en apesanteur dans l’espace. L’atmosphère peut être drôle ou étrange, voire angoissante. A sa façon de décrire des meurtres sanglants, de leurs préméditations à leur absence de justification, il semble que le but soit de provoquer des chocs visuels et moraux, à la manière de certaines comédies horrifiques. De ces univers, Nudy a parfaitement synthétisé le côté volontairement grotesque, au sens quasiment premier du terme, qui déforme et rend difforme la réalité pour que le comique et la terreur surgissent ensemble. Sa voix légèrement pitchée et les ad-libs qui ne laissent pas une seconde de répit entre les lignes recréent même le rythme et la patte burlesque de ces films. L’étrangeté provient du décalage entre son timbre, le ton des productions et le contenu des textes. Ses fables ultra violentes et cyniques peuvent être racontées sur des nappes légères et lancinantes ou fredonnées sur les mélodies d’un dessin animé. L’écart entre ce qui est dit et ce que l’on entend donne un côté dérisoire au sordide, surtout quand Nudy laisse éclater son ricanement moqueur, qui rappelle autant un gremlin que le jeune Gucci Mane.
Lucki, FLAWLESS LIKE ME
Depuis l’excellent et étrangement sous estimé The WIZRD, Future a perdu de sa superbe. Il y avait pourtant une nouvelle direction à creuser suite à cet album qui est peut-être l’un de ses plus raffinés, avec son enchevêtrement de textures baroques, ses mélodies dissimulées sous les tons rêches et son atmosphère expressionniste. Mais Future a préféré se vautrer dans le gothisme haute-couture de Kanye et limiter son personnage à celui des « memes » twitter sur la masculinité toxique. Pour retrouver toutes les facettes que sa musique a perdues, il faut chercher un peu chez Babyface Ray, un peu chez Baby Smoove, et pas mal chez Lucki. Depuis sa réinvention en romantique déçu, dépravé et mélancolique, aux alentours de la sortie de Freewave 3 il y a quatre ans, c’est chez lui que l’on retrouve ces mélodies qui font peser un spleen accablant, surgissants au milieu des bruits mécaniques et du son des diamants brisés qui s’entrechoquent.
CEO Trayle, HH5
CEO Trayle est à Lil Baby et Gunna ce que Rocko était à Future et Gucci Mane. De prime abord, un succédané, mais par le choix de ses productions aux textures riches et cohérentes entre elles, par la finesse de l’écriture de ses mélodies et du concept de ses chansons, Trayle se révèle être attrayant par lui-même, pour son univers, sa personnalité propre, et pas seulement pour les qualités qu’il partage avec les stars d’Atlanta. Happy Halloween 5 est composé comme la bande son d’un film d’horreur au ton maussade, sinistre, et étonnamment uni malgré la diversité des styles. L’origin story du protagoniste est un événement réellement survenu dans la vie de CEO Trayle, qui joue avec son dédoublement de personnalités pour exorciser de vieux traumas.
Seiji Oda, lofi // HYPHY
Seiji Oda désirait mélanger la culture de ses parents aux sonorités du rap de la Bay Area. De la rencontre entre l’ambient japonais et les rythmiques hyphy ou ratchet qui font grimacer les fantômes, on pensait voir naître une musique étrangement hybride, entendre l’argot des rues d’Oakland chuchoté dans Tokyo ou imaginer des concours de drifts silencieux sur le parking d’une bibliothèque. lofi // HYPHY est exactement cela, mais ce n’est ni étrange ni hybride, simplement dans la continuité de ce que faisaient parfois IAMSU, le Heartbreakgang et cette génération autant inspirée par la culture des grands frères que par le R’n’B moderne. La vraie surprise provient des talents de chanteur et de mélodiste de Seiji Oda, qui sur l’ultime chanson du disque arrive même à déclencher un léger frisson glacé aux fans de The Jacka.
Baby Smoove, I’m Still Serious 2
Les sonorités sont apathiques, l’attitude est léthargique, et tout évoque l’absence total d’exercices physiques, y compris son obsession pour le sexe, qui n’aboutie qu’à des pratiques passives. Smoove décélère volontairement et à outrance son débit, baisse sa tonalité pour faire ressortir exagérément le coassement de ses cordes asséchées par la codéine. C’est comme s’il sortait constamment d’un sommeil profond et prolongé, pour venir tenir des propos outranciers qu’il aura oubliés après s’être rendormi promptement. Il n’accepte ni la frustration matérielle, ni la compromission sentimentale, et le maelström hallucinogène provoqué par la dissonance des productions et de sa voix, laisse entendre que la codéine le libère de ces tracas. Dans son cocon embrumé par les nappes vaporeuses, les mélodies louisianaises synthétiques et le grésillement des basses, il trouve, et offre, un plaisir immédiat, qui dilate le temps et l’espace pour créer une sensation d’oubli éphémère. Bercé par son flow désabusé, on retrouve et partage l’impression de défonce et d’ivresse.
S5, Before The Fame / R3, Wock Pint Freestyle
De tous les fils illégitimes de Drakeo The Ruler, S5 est celui qui arrive le mieux à faire perdurer l’ère Cold Devil, son lexique horrifique codé et le stress permanent de son atmosphère volontairement anxiogène. R3 lui, est plus proche de ce qui vient de Sacramento, du regretté Young Slo-Be, des prod. hantées par le chien des Baskerville et striées de rayons lasers. Dans tous les cas, une Californie où le soleil n’a pas l’air de se lever très souvent.
Idontknowjeffery, F-Type Music Deluxe
L’histoire d’un pimp pince-sans-rire du Tennessee qui ficelle des gens après les avoir menacé avec un vagin en plastique. C’est immoral, méchant, violent, malin et drôle. Produit par un étudiant du rap de Memphis des années 1990, sobrement intitulé Diabolus Exterminus. Mention pour son EP avec RXK Nephew, contenant un titre sur l’augmentation du prix de l’essence et un bel hommage à OJ Da Juiceman.
NBA Youngboy, 3800 Degrees
Le rap de Louisiane s’incarne absolument partout. Dans les productions de Top$ide pour RX Papi, Shaudy Kash, Los, Babyface Ray, Veeze ou Baby Smoove, dans le canvas et l’esprit des raps du Michigan, de Floride, de Californie, d’Atlanta, dans les flows de Chief Keef et de Bankroll Fresh, souvent empruntés aux Hot Boys et qui continuent de faire école. Il y a d’abord eu une reprise de C-Murder, adoubée par l’intéressé, puis NBA Youngboy s’est décidé à rendre hommage à sa culture avec un album invoquant tour à tour Boosie, Webbie, Soulja Slim, B.G., Kevin Gates ou le jeune Lil Wayne. Il apparaît revigoré par ces productions purement gangsta bounce, et retrouve une rage cathartique de solja, qu’il a parfois perdue sur ses longs albums.
Tony Shhnow, Reflexions
Shawny Binladen, Boogie Man Wick
Lil Uzi Vert, Just Wanna Rock
Pour qui n’était pas convaincu qu’Afrika Bambaataa et Chief Keef appartenaient au même genre musical, Uzi Vert a placé une balise à mi-distance entre Planet Rock et Go To Jail.
Lil Yachty, Poland
Deux apprentissages essentiels, à retenir de ce que Lil Yachty a réalisé avec Poland. D’abord, et même si la décision leur appartient, les artistes ne devraient pas automatiquement laisser mourir leurs démos et morceaux inachevés quand ils ont eu le malheur de ‘fuiter’. Ensuite, et surtout, ne jamais snober les leaks. Qu’ils soient des titres orphelins uploadés sur YouTube ou des dossiers de plusieurs giga octets, les ignorer revient à se contenter des albums studios à l’époque où tout se passait sur mixtapetorrent. Des chansons comme Poland, il en existe des dizaines, qui apparaissent chaque année depuis l’apogée de Lil Wayne. Et comme pour ce dernier, le meilleur de Young Thug, de Chief Keef, de Playboy Carti et de tant d’autres, se trouvent parmi ces titres. De la même manière qu’on ne peut pas comprendre Lil Wayne et Gucci Mane en ne connaissant que les Carter et les Trap God, se borner à ce qui est disponible sur les services de streaming revient à passer à côté du coeur de l’oeuvre des rappeurs les plus inventifs depuis quinze ans.
Ka, If Not True
Quand l’auteur de la discographie la plus solide de l’histoire du rap se laisse posséder par l’esprit de Charly Wingate, pour nous envouter comme le serpent du Livre de la Jungle, ayons confiance.
Yung Kayo, It’s a Monday / YEET (feat. Yeat)
Aujourd’hui, des trolls phosphorescents nés dans des ordinateurs rappent en s’inspirant de Slim Jxmmi et de Trippie Redd comme d’autres avant eux étudiaient Jay-Z et Nas au microscope.
La musique de Yeat se joue dans les détails. Comme dans un jeu vidéo proposant plusieurs voies navigables, les chansons prennent des tournures sensiblement différentes en fonction de l’élément sur lequel se concentre l’oreille. Préférez-vous suivre la basse qui bourdonne, la sonnerie de téléphone, le synthétiseur arc-en-ciel, le marteau de thor métallique, les gargouillis saturés, les charlestons lasers ? Il y a potentiellement autant d’expériences d’un titre de Yeat qu’il y a d’auditeurs. D’ailleurs, personne n’a les mêmes préférés. Petite faiblesse pour Lüh Geek ou Taliban, qui avec leurs cloches d’église tracent un lien entre le rap cybernétique des fils de Carti et Uzi Vert et la trap originelle de Drumma Boy et Zaytoven.
Veeze, Let It Fly / Close Friends
L’arlésienne Ganger, album le plus attendu de 2023 (ou 2024 ou 2025 ou 2026).
Louie Ray, Start / Enrgy, Awful Lotta Yeah (Ft. Babytron)
Difficile pour Flint de préserver le momentum après l’incarcération de son meilleur rappeur. Louie Ray doit être celui qui a su le mieux maintenir l’intérêt et faire honneur à Rio. Enrgy lui, est resté cette année encore un des producteurs les plus fun en activité, capable de transformer en missiles de guerre les génériques d’Harry Potter et de Star Wars comme de sampler Charles Aznavour pour Babytron.
French Montana, Blue Chills
Depuis toujours, la musique de French Montana et d’Harry Fraud repose sur des ressorts nostalgiques : la tonalité mélancolique des flows et le pitch éthéré des samples créent l’impression d’être le personnage principal d’un film pris dans un flash back. Avoir attendu quinze ans pour faire cet album a permis aux adolescents qui écoutaient Playin In The Wind de devenir des adultes réellement nostalgiques de quelque chose.
Kendrick Lamar, Rich Spirit
La meilleure chanson du dernier album de Kendrick Lamar est une réinterprétation de l’Impatient Freestyle de Drakeo The Ruler, et rien ni personne ne pourra le faire entendre autrement. LLTR
illustration : Hector de la Vallée