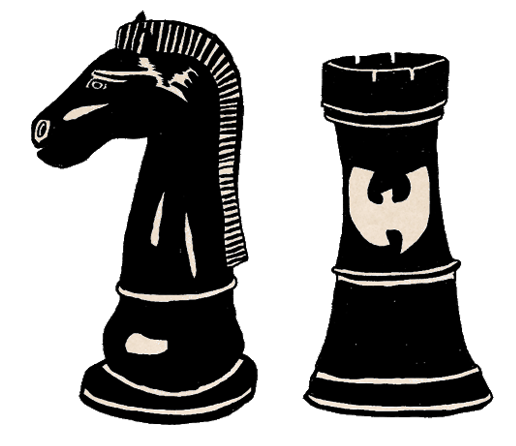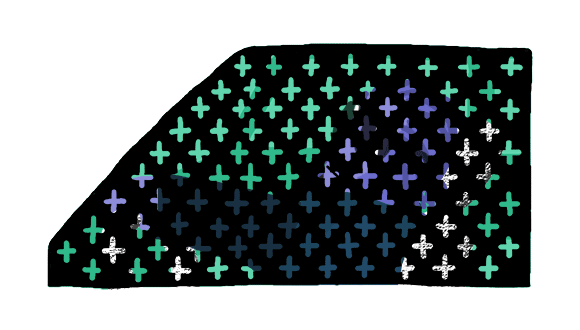Enfin. A lire impérativement dans les conditions de son écriture, soit avec cinq drogues minimum dans le sang, et O Fortuna (Carmina Burana) de Carl Orff en fond sonore. Go.
TELL’EM
Au plus haut de la canicule de 1995, le général Percy Miller reliait d’un trait les 3660 kilomètres qui séparent Richmond de la Nouvelle Orléans, débout sur le toit d’un Tank forgé dans l’Or des Nazis. Sa croisade pour la reconquête des terres sauvages de Louisiane scella pour toujours le destin des sirènes g-funk à celui des tambourins militaires de KLC. Ce que les 504 soldats sans limite ont accompli, Richard Morales a.k.a Gunplay Don Logan Jupiter Jack Daniels, le commet en solo. Initié à l’art des chamanes Yoruba, il invoque tour à tour les fantômes de Mystikal, Mia X, Silkk Tha Shocker, Kane et Abel. Ce belliqueux marlou devient semblable à une armée, et son remake du Hot Boys & Girls de Master P, pareil à une manchette main nue de Kimbo Slice sur une oreille gelée par l’hiver continental. En guise d’introduction, Don Logan se présente avec un portrait chinois, quatre minutes et seize secondes plus tard, l’image d’un gorille sous bath salt est gravée derrière nos paupières boursoufflées par la violence. D. Rich y ajoute un frotté à la corde de marin, pour transformer cette épopée No Limit en scène coupée de Jaws : Gunplay et sa dentition de requin sont derrière vous, le péril est imminent.
JUST WON’T DO (Feat. PJK)
Le fil reprend à l’exact instant où nous étions restés, groggy, après la plus grande tornade de rimes internes de l’Histoire. On sait désormais que l’autoroute qui mène au paradis se traverse avec le Livre posé derrière le pare-brise d’une Porsche 911. Le sample commandé sur les terrasses du Café del Mar ne laisse aucun doute sur l’intention du morceau : Gunplay fait face au passé et au destin comme s’il surfait un océan nommé d’après le mot grec qui signifie espoir. La suite de Bible On Da Dash sonne comme le come back d’un homme qui vient d’échapper à la prison à vie, parce qu’il s’agit du come back d’un homme qui vient d’échapper à la prison à vie. Côte à côte, les deux chansons illustrent le monologue de Frank Semyon pour le fils de son associé mort : « A thing that splits your life – there’s a before, and a after. » Le producteur, Mike Mulah, est un ancien DJ de House poudrée, qui depuis deux ans n’a cessé de réunir Gunplay et Peryon J. Kee autour de leur amour commun pour le rap introspectif hautement chargé en prométhazine, qu’il soit d’inspiration Texane ou nord Californienne (Get Like Me, It’s Goin Down). Cette nouvelle collaboration aurait pu être un duo Jacka – Husalah, si le premier avait réussi à fuir la rue, et que le second n’était pas une saloperie d’indic’.
BE LIKE ME (Feat. Rick Ross)
Même quand son lieutenant chasseur de rêves se fait malmener par le Julien Clerc du pauvre, le Teflon Don ne bouge pas d’un iota. Il l’observe se faire dévorer par des chiennes en dégustant des chicken wings à l’arrière de sa Bugatti Phantom, déjà prêt à le faire disparaître des photos comme un vulgaire Nikolaï Iejov. Dans le coffre, le fusil d’assaut est d’origine russe, parce que l’adrénaline dégagée par ce track est similaire à celui pompé par le cœur noir de Joseph Staline pendant les grandes purges. Pour être comme Ross et Gunplay il faut vendre son âme, ou au moins la mettre en location. La bible sur le tableau de bord est là pour détourner l’attention, ce sont les bougies et les crânes en os de porc qui protègent Gunplay du serpent, de la mort et de l’incarcération. Est-il nécessaire de rappeler ce que Richard Morales s’est fait tatouer sur la nuque ? Après Real Niggas et Aiight, Be Like Me clos une trilogie qui finit d’asseoir les deux compères comme les Satanas et Diabolo de l’extermination par drive-by, avec code munitions illimités. Et si sur le pont Rick Ross déterre les corps de Boyz N Da Hood, la prod. de Beatbully instaure la Menace comme Quincy Jones III.
ONLY 1
A la façon de Cam’Ron sur le deuxième couplet d’Horse & Carriage, Gunplay joue à Mr. Me-Too. Un rappeur de Floride est obligé de payer son tribut à celles qui y dirigent l’industrie en secret. Mères et sœurs, femmes et amies, ce sont les travailleuses du King Of Diamond et du Take One Lounge qui font la pluie et le beau temps des carrières locales. Only 1 est cet obligatoire passage pour Clubs de Gentlemen, avec ses rayons lasers hard trance et les beuglements crunk du Prophet Posse au complet. A jouer entre Drop et She Get It, pour être sûr de provoquer l’averse de Présidents Morts sur les parades de silicone. Fort à parier que si Gunplay ne foutait pas autant les miquettes ou qu’Only 1 et son gimmick un poil fainéant appartenait à un rappeur plus populaire, cette chanson abreuverait les lecteurs mp3 des collègues aux jeans retroussés du service marketing. Malheureusement pour eux, fidèle aux enseignements des pères spirituels Trick Daddy et JT Money, Gunplay ne sait faire danser qu’à grands coups de râles agressifs et au son des armes à feu.
FROM DA JUMP (Feat. Triple C)
Ce à quoi ressemblerait Started From The Bottom, enregistrée dans une turbine à gaz combustible, chantée par quelqu’un qui vient vraiment d’en bas, et sans aucune envie d’aller voir ailleurs. Le producteur Andrew Bulogh est claviériste et saxophoniste pour le nouveau groupe d’Eric Wilson, ex membre du trio punk californien Sublime (Des fans de Steady B et des Geto Boys). Que ce groupe ait une chanson intitulée Santeria n’est pas un hasard, simplement l’un des mille et un secrets dissimulé en LL (without the Cool J). La drogue, les cheveux sales, les mosh pits, évidemment que comme beaucoup de gangsta rapper avec une culture club, Gunplay est un peu punk. Il fallait au moins Bulogh et son pizzicato en ébullition pour donner un souffle barbare, un remous hard-rock, à Living Legend. N’oubliez jamais que Jupiter Jack a partagé un line-up avec les démons grindcore de Napalm Death, et qu’il égorge des porcs en l’honneur de divinités hérétiques tout en criant « Free Rozay ». C’est un peu la version iMax grand spectacle de Killswitch, tout premier single cru 2008 qui, à l’époque, annonçait l’album éponyme. Vous savez, celui qui est devenu Valkyrie, puis Bogota, puis Medellin.
WUZHANINDOE (Feat. YG)
Tel Jean-Luc Petitrenaud, Morales n’oublie jamais d’agrémenter ses projets d’une petite escapade gourmande en terre promise du gangsta rap. Cette fois, Logan suit les conseils prodigués par E-40 en 1994 et lâche des bombes sur vos mamans comme Ice Cube en 1992. Il suffit de ces petites références au facteur et au prédateur pour transformer ce qui aurait pu être la verrue cross over de cet album en menace terroriste, et faire trembler la dernière main valide de Jean-Hugues Anglade. Et sous ces braggadacii, les synthés de DJ Mustard deviennent l’alarme des Chevrolet retournées par The Human L.A. Riot. On raconte que si Lamar Duckworth s’est récemment acheté la garde robe de Lakim Shabazz, c’est suite au traumatisme infligé par le couplet à vif de Gunplay sur Cartoon & Cereals. Ce dernier aurait pu en profiter pour lui piquer une compo de Terrace Martin, mais rapper sur des faces b west-coast fait partie des traditions incontournables de ses projets.
CHAIN SMOKIN (Feat. Stalley & Curren$y)
Quand quelqu’un tousse en avalant sa première bouffée de doobie, les chances qu’un refrain de Devin The Dude se lance sont extrêmement élevées. Pas cette fois. Le Redman post-Flockaveli a parfois besoin de se détendre, siroter un petit café cubain en jouant à Fight Night sur X-Box 360. Mais étant en conditionnelle, il vaut mieux que la seule chose blanche avec laquelle on le voit soit sa Chevrolet couleur neige éternelle, intérieur crème dessert vanillée. Alors, il sort le vapo, invite les copains du rap d’ascenseur et décolle pour la chambre 420. Le producteur Mighty Joe est l’homme derrière les mix et mastering des récents EP du rêveur éveillé Curren$y, notamment celui où Gunplay fait une apparition. C’est le claviériste Eddie Montilla qui assure l’atterrissage, légende Porto Ricaine qui a rejoint l’équipe de Logan depuis son génocide sur Ghetto Symphony. Michel Muller vous le dirait : Gunplay, fallait pas l’inviter, il vous vole la vedette et vos collaborateurs.

WHITE BITCH
La séquelle de Cocaïna (Que Linda) est une nouvelle ode à l’ex amour de sa vie. Pas de coup de téléphone nocturne et gênant, si celui que l’on appelait Mr. Five Drugz Mini est parmi nous, c’est d’abord pour se marrer avec sa livraison de syllabes souples comme une pate à cookie sans bulle. Place à la célébration fun et hyper synthétique d’un produit pas toujours fun et d’origine naturelle. Et si ces nappes stridentes étaient les sirènes du Bout It Bout It d’un monde où l’EDM a infiltré le rap façon Donnie Brasco ? L’apparition dans le clip du Cocaine Cowboy Mickey Munday est la cerise qui vient rappeler cette époque où Ratchet Morales habillait sa mixtape avec des reniflements. C’est fou à quel point en réécoutant son First Gram on entend jusque dans sa voix que son rythme cardiaque est six fois supérieur à celui d’aujourd’hui. On espère que Netflix aura quand même le bon goût de faire appelle à The Original Overdoser pour la B.O. de sa nouvelle série sur le grand Cartel de Pablo Escobar.
BLOOD ON DA DOPE (Feat. PJK & Yo Gotti)
Ni bras ni marteau dans l’Hannah Montana, le film. Mais il ne s’agit pas que de cela, avec ce storytelling, Jupiter Jack Daniels révèle que son fétichisme pour la pureté va bien plus loin qu’une haine pour le bicarbonate. Après un débriefing officiel de l’album, il a été suggéré que le sang sur la drogue ou les billets était aussi une métaphore de leur traçabilité. (Ou comment une réunion Illuminati s’est transformée en version lourdement alcoolisée de Rap Genius). Bref, si PJK veux devenir le nouveau Omar Little, il devra bien faire attention qu’on ne puisse pas remonter jusqu’à lui. Le Dr. Lecter rangera certainement ce titre entre Mask On et Drop Da Tint pour parfaire le profil psychologique du psychopathe Morales. Quant aux frères Roc N Mayne, ils étaient déjà derrière la prod. inquiétante de Windows of My Eyes de Boosie. Des gars qui ont donc fait ce choix de carrière risqué de ne travailler qu’avec des fans de Tupac passés à rien de mourir dans une cellule. Clairement une voie de garage.
DARK DAYZ
Produit par Onassis des Morris Brothers, qui était déjà sur la plage arrière de Bible On Da Dash, le classique instantané Dark Dayz est un remake de la performance coupe gorge de Gunplay sur Cartoon & Cereals. On y retrouve cette impression qu’il est entré dans le booth à poil et sur un coup de tête, pour se vider le cœur et l’esprit sans calculer le coût ni réfléchir aux conséquences. Inside I’m Sufferin’, Outside I’m Stuntin’ est la devise qui résume à merveille l’art et l’attitude de Richard Morales, et on est ici en plein dans l’un de ces moments où il laisse entrevoir ce qu’il cache derrière son écran de fumée noire comme l’orage. No mic, no camera, no light, just pain et son propre couteau de chasse sous la jugulaire. Perdu entre les rebondissements d’une vie de roman, et le fait de n’être qu’un énième numéro sur une fiche statistique, le Logan chair à nu est toujours le plus captivant. Sur un piano échappé d’un soap opéra, chaque ligne de ces six minutes de bave acide sur les 12 travaux du Rich’ pourrait finir en motto tatoué sur le dos d’un condamné à mort. Comme Housni, Gunplay ne pleure pas mais son écriture est salée. Seulement, cette fois, et comme de nombreuses fois, personne n’y fera attention, parce qu’il n’y a pas de rappeur de première division présent pour gâcher la confession.
LEAVE DA GAME (Feat. Masspike Miles)
En 1999 Too $hort prenait conscience du terrible mal qui l’habite. Il est accro, et il aura beau tout essayer pour arrêter, l’hypnose, les patchs, le conditionnement pavlovien, il n’arrivera jamais à abandonner, le plaisir est trop immense. Sur un retour de vague de cette bonne vieille vibe soulfull Deeper Than Rap, Gunplay livre sa version du Can’t Stay Away. Et il raconte sa Children Story avec une interpolation de Slick Rick, comment ne pas croire que cet amour est bien réel ? Le message est clair : Quand on vient de nulle part, chaque pas s’apparente à une victoire en League des Champions. Et grâce à Leave Da Game, on arrive à imaginer la sensation qu’offre la sortie d’un premier album en major, après avoir traversé la Vallée de la Mort au volant d’une voiture volée. C’est la guitare de Memory qui fait ses allers-retours sur tout le morceau, pour raviver le souvenir du grand N.O. Joe et de toutes ces légendes, vivantes ou pas, qui observent Gunplay de là où elles sont, en hochant la tête au ralenti.
OUTRO
Living Legend confirme tout ce que l’on sait de Gunplay, qu’il est l’underdog ultime, un rappeur au talent immense mais qui n’atteindra probablement jamais son plein potentiel sur un long format. LL fait l’effet de ces séries cultes qui, quelques années après la fin de leur diffusion, ont le droit à une adaptation bilan et policée au cinéma. C’est un aperçu de tout ce que Gunplay sait faire, une compilation de chaque facette de la personnalité qu’il met en scène depuis maintenant dix ans. Et après tout, à presque 40 ans, il vient d’une époque où un album en major était construit comme un showcase du salon de l’auto. Alors, il y a souvent un air de déjà-vu, surtout si on suit l’énergumène à la trace depuis ses freestyles sur des faces b de Snoop et Trick Daddy. Mais le simple fait que ce disque soit dehors est un événement en soit, au delà de l’attente, des reports, des rebondissements qui ont jalonné son enregistrement et la vie de Richard Morales. Simplement parce que Gunplay est aujourd’hui un rappeur complètement anachronique. Aussi passionnant et charismatique en interview quand il raconte sa vie, que sur disque, quand il choisit ses mots et ses notes, ses flows et le ton de son interprétation, comme s’ils étaient des éléments absolument indissociables. Un rappeur total, sans phare, identique en et en dehors des studios, parce qu’il ne conçoit le rap que comme un moyen comme un autre d’être lui même. Les rappeurs de cette trempe sont en voie de disparition des couloirs des majors. Ils en ont fait les beaux jours, en ont même été les Rois, mais depuis les millions perdus suite aux incarcérations des uns, au comportement des autres, les majors ne sont plus disposées à prendre le risque de gérer ce genre de personnages bigger than rap. Surtout depuis la lente agonie de leur business. Gunplay est un des derniers Mohicans avec un contrat en grande maison. Et si ça ne suffit pas à donner envie de laisser une chance à son album, sachez qu’on y retrouve les traces de ce mélange de communications ultra codées, d’énergie, de rage et de peine qui en ont fait, malgré tout, l’un des talents les plus bruts de ces dix dernières années.
Hey, huit ans que j’attend de pouvoir écrire quelque chose sur ce disque, si un album est un événement pour au moins une personne sur terre, alors C’EST un événement.
SCORE ( /5 )





illustrations : Lasse & Russe