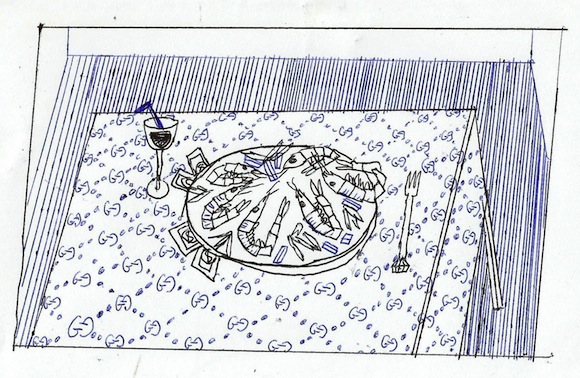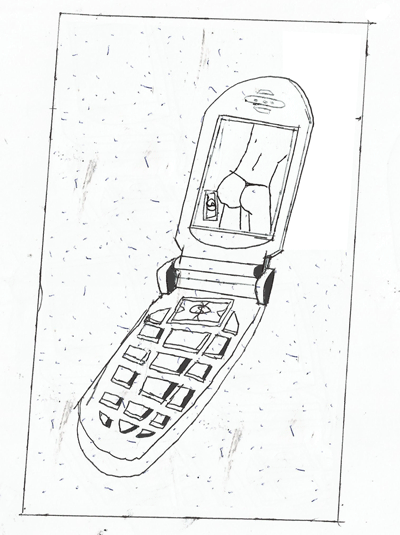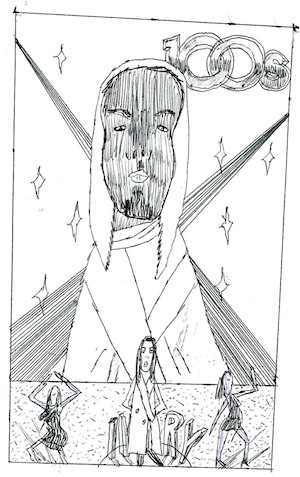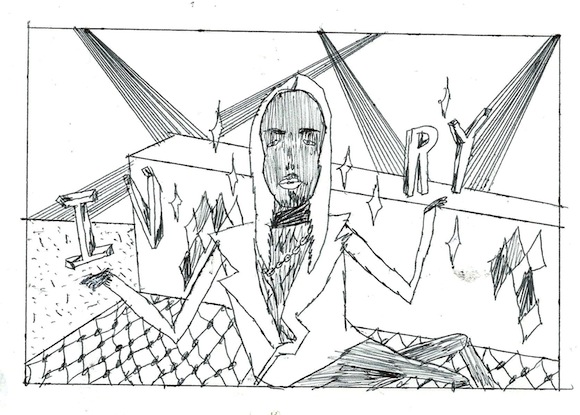Ka « 1200 B.C. »
Avec un EP de dix minutes fait de cinq pistes dont un skit et un extrait, il y a de quoi rester sur sa faim. Pourtant, ce nouveau projet de Ka rempli plus que bien son rôle apéritif. C’est incroyablement dense grâce aux textes à tiroir du rappeur, toujours remplis de doubles sens qui ne se révèlent qu’avec des écoutes attentives et répétées. A la fin du projet, le nombre d’images assénées par Ka, comme autant de coups sur la nuque, laisse l’impression d’avoir visité un univers immense, entrevu à travers une accumulation de détails : des cafards grouillants sur un carrelage, des rêves perdus de richesses, des proches qui essaient de survivre. Et en fond, Brooklyn, qui se dessine comme un champs de ruine antique, sale et écroulé. Au milieu de cette atmosphère étouffante, et à côté du très sobre Ka, Roc Marciano surgit comme un super héros pimp tout en décalage. Ce nouveau bout de collab’ entre les deux amis renforce l’attente pour leur album commun et l’idée que Metal Clergy est un des duos de rap qui fonctionne le mieux aujourd’hui. L’ensemble des productions est assuré par Preservation. Malgré la présence de drums, et même si elles sont globalement moins marquantes que ce qu’avait livré Ka l’an dernier, elles n’auraient pas dépareillé sur Night’s Gambit. Moins oppressante que sur l’album, la musique garde un grain poussiéreux et le minimalisme qui épouse bien le flow conversationnel de Ka. 1200 B.C. n’est disponible qu’en CD, sur le site du rappeur.

BeatKing « Gangsta Stripper Music 2 »
BeatKing est le Casino de Houston. Sachant ça, on peut imaginer à quoi ressemble une bonne partie de sa tape juste grâce à son titre : C’est du rap gorille de strip-club texan, une suite de bangers faits de basses qui font trembler la cellulite comme des flambys, de nappes lentes comme une coulée de lave pourpre, de refrains chantés par des grosses voix de soulmen et de notes de synthé entêtantes… Mais pas que. Parce que si la première partie du projet est effectivement une version surtestostéronée, hypersexuelle et moderne du rap de Swishahouse/S.U.C., avec des prods de Mr. Lee, des apparitions de Lil Keke ou Michael Watts, la seconde moitié de la tape nous décale vers le Memphis du début des années 2000. Gangsta Boo et Skinny Pimp font leur arrivée, et les prods de BeatKing deviennent des remakes de tubes de la Three 6 Mafia période crunk, avec ses voix screwed qui tourbillonnent sur elles-mêmes et ses ambiances à mi-chemin entre le club et le cimetière. Injustement ignorée, Gangsta Stripper Music 2 est le meilleur projet de BeatKing à ce jour et l’une des mixtapes de club-rap les mieux produites de ces derniers mois.
Best track : ClubGodzilla, avec ses relents de sirènes de stade « who da crunkest » et des cris de ptérodactyles épluchant des liasses sur les plus gros culs de la planète.
HD « Bad Habit (Stuck In My Old Ways) »
Pour peu qu’on adhère à sa formule, le rap sans chichi d’HD déçoit rarement. A vrai dire, tout ce qu’on lui demande c’est de continuer à raconter sa réalité de petit débrouillard, sans faire de cinéma. D’être lui-même, en somme. Mais ici, la petite vie sans issue et les luttes quotidiennes d’HD gagnent une nouvelle dimension grâce aux Mekanix, qui produisent l’ensemble du projet. La récurrence des samples de soul pitchés crée une vraie cohésion, ce qu’HD n’arrive pas toujours à obtenir sur ses disques, et une douceur qui tranche avec le contenu parfois dur des textes, rappelant le « Dope Boy Blues » des dealers d’Akron dans l’Ohio. En plus, le boss de Bearfaced semble progresser au micro. Presque street-crooner sur les rythmes cosy, il s’adapte aux prods plus agressives, avec un flow offensif qui révèle le grain rugueux de sa voix. Bad Habit est de loin le meilleur album du jeune prince d’Oakland depuis Breakin’ N Enterin’ il y a deux ans.
Best track : Stuck In My Old Ways, où HD explique à son ange gardien qu’il est prisonnier de son amour pour les guapale. Une des plus belles prod du disque, avec une voix de sirène qui entraine le rappeur à venir s’échouer sur les ennuis.

Sen City « Schemin & Dreamin »
Jim Jones a rejoint la communauté des vampires d’Harlem juste après l’incarcération à vie de sa muse en 2009. Pour entrer dans cette société secrète, l’ancien Capo du Dipset a fait ce qu’il sait faire de mieux : sacrifier ses sous-fifres. En échange de leurs âmes, Alucard, prince des vampires, leur a offert la jeunesse éternelle et les clés pour continuer à faire du rap sans trop tourner en rond. Depuis, cette meute de noctambules sort au moins un projet par an, puisant dans les sonorités les plus noires de l’héritage Dipset. Cette année c’est Sen City, la réincarnation ratée de Max B, qui s’y colle. Les boucles de pianos, les synthés retro futuristes et les mélodies spectrales sont étouffés pour rappeler l’acoustique des longs tunnels d’autoroutes ou des chapelles d’églises. On a vraiment la sensation que tout a été enregistré à l’extérieur, en pleine nuit sous un pont d’Harlem. Sen City n’a plus qu’à pousser sa voix comme un loup qui hurle après la lune pour ressusciter toute la mélancolie des refrains de Biggaveli. Jim Jones, Cam’Ron, 2 Chainz et Araabmuzik apportent la touche finale pour faire de Schemin & Dreamin le premier vrai projet solide de Sen City.
Best track : Cloud Surfin. Le producteur Kino Beats enfile son costume de DJ Burn One pour jouer d’une guitare country rap tune pendant que Sen sort sa meilleure imitation de Max B sur le refrain. Owwwwww.

Fat Trel, qui avale ses syllabes comme le cookie monster sur « Gleesh » ; King Louie, qui prend le meilleur de son passage par Yeezus et monte en puissance sur « Tony » ; Young Scooter, qui supplie Dieu de ressusciter les morts et de protéger ses enfants sur « 80’s Baby » ; Travis Porter, qui rappellent qu’ils sont le trio le plus fun d’Atlanta sur « Music Money Magnum 2 » ; Slim400, qui démontre qu’il n’y a pas que YG à Compton en 2014 sur « Keepin’ It 400 » ; Lil Durk, qui confirme que la vraie star de Chicago, c’est lui, sur « Signed To The Streets 2 »

Big Hit « G’z Don’t Cry »
Comment est-ce qu’un mec approchant de la cinquantaine et rappant comme ça n’a t’il pas percé plus tôt ? C’est simple, comme il l’explique lui même sur Grindin My Whole Life, Big Hit a été mis en boîte en 1991… et vient seulement d’en ressortir. Je vous laisse faire le calcule. En entrant en prison, il avait laissé un fils de quatre ans. A sa sortie, il a retrouvé un jeune homme devenu une machine à tube. Big Hit est le père de Hit-Boy, donc en plus d’avoir cette attitude d’OG bien appréciable et son rap gorgé d’expérience, il est a peu prêt assuré d’être servi en productions de qualité pour pas trop cher. Grindin My Whole Life a étrangement échoué à devenir un gros tube, potentiellement parce qu’il a été vampirisé par le freestyle du G-Unit, et G’z Don’t Cry, deuxième apparition ever de Big Hit prend le même chemin. Pourtant, entre la production ensoleillée aux basses cuivrées d’Hit-Boy et le rap de vieux voyou émotif de son père, on tient un morceau parfait pour verser de la 40oz sur le bitume brûlant cet été.
Peryon J Kee « Actavis »
Peryon J Kee est le seul artiste signé sur Bilderburg Group à avoir un semblant de carrière. Originaire de New-Orleans, Peryon perpetue la tradition des louisianais qui font du rap texans. Et du haut de la petite poignée de tapes à son actif, il peut se targuer d’avoir une dizaine de vrais bons morceaux, entre collabs avec E.S.G. ou AP9, et hommages au rap de Pimp C. Planant au dessus du reste de sa discographie, il y a évidemment ses duos avec Gunplay, comme le laidback Goin’ Down dont le clip imbibé de culture texane commence même à tourner sur MTV. Avec sa voix de canard et son talent pour les refrains, Peryon pourrait n’être que le simili Nate Dog de Bilderburg Group, mais avec son dernier single Actavis il montre qu’il est capable de tenir un morceau tout seul.
A-Wax « No Limit »
Parfois il ne suffit pas de grand chose pour réussir un titre. Un bâton de pluie électronique, une raison pour faire référence à plein de rappeurs de No Limit, et on est bon. Pullin’ Strings, le nouvel album d’A-Wax sort fin juillet, et pour l’instant tous les extraits sont excellents. Dans le plus grand des secrets ce mec possède l’une des discographies les plus impressionnantes de la côte-ouest.
Chinx Drugz & French Montana « The Silence »
The Silence n’est disponible que sur la version iTunes de Cocaine Riot 4 et en est le meilleur morceau. Harry Fraud au sommet de son sample grillé jeu, mais qui arrive à créer cette sensation de grand large en travaillant l’écho de sa guitare. Les deux Coke Boys ont l’air d’être perdus en haute mer et s’adonnent à ce qu’il font de mieux : fredonner n’importe quoi, pourvu que la note soit bien choisie.
Taylor Bennet & King Louie « New Chevy »
Peut-être avez vous adoré le très réussi Acid Rap de Chance The Rapper. Ou peut-être que son « nyanyanyanya » nasal vous donne la diarrhée. Peu importe, voici un morceau qui pourrait réunir les fans et les détracteurs du sosie américain de Ben l’Oncle Soul. Taylor Bennet est le petit frère de Chance. Il a la même tronche, la même voix, mais a été assez sage pour ne pas copier les tics les plus agaçants de son frère. Et, surtout, assez malin pour devenir copain avec King Louie, soit la raison qui pousse à cliquer sur le lien vers le morceau. Petite prod sucrée pour que Louie modifie nonchalamment l’haleine des filles avec sa quéquette. C’est l’été sur purebakingsoda.
A retrouver, avec une petite dizaine d’autres tubes, sur la seule compilation estivale approuvée par les autorités compétentes.
Télécharger PBS.SummerHitsOnly.rar
Illustrations : Hector de la Vallée